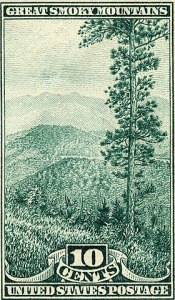« Deux décennies et des pouces après sa condamnation, Carlotta Mercedes se préparait pour son cinquième passage devant la commission de libération conditionnelle de l’État de New York. Elle savait que ses nombreuses années de mitard ( H23 et 7 jours sur 7, sans télé, sans radio, sans livres, ni contact physique agréable) la planteraient sans doute de nouveau cette fois-ci. Avec tous ces séjours au trou, elle n’avait pu finir aucun de ces programmes de désintox qui plaisaient tant aux crânes d’œuf. Mais être restée trop longtemps à l’isolement n’était encore pas le pire de ses handicaps. Mauvais comportements, qu’y disent ces connards, mais pour eux mauvais comportement c’est si tu gueules quand un maton t’fouette comme un fudge cake Betty Crocker. Pourquoi est-ce qu’on n’arrêtait pas de la frapper? »
Eh bien voici un drôle de roman à savourer pour sa verve, son humour ravageur et rageur, pour Carlotta, évidemment, un superbe personnage tour à tour drôle, émouvant et très intéressant. Carlotta Mercedes, ce n’est pas n’importe qui, une sorte de prototype de personne courageuse, pleine d’une pulsion vitale incroyable, à la langue bien pendue. Mais pour moi, Carlotta est surtout bouleversante. Voici un livre pour lequel il faut saluer chapeau bas la traductrice. C’est je suppose un tour de force que de rendre en français le langage, la langue de Carlotta, son débit de parole, ses tournures de phrases improbables, et le contenu argotique, mais pas seulement, on se dit que la langue de Carlotta n’appartient qu’à elle; elle dit des choses qui font frémir, vibrer, pleurer ou rire, mais Carlotta sait parfaitement s’exprimer au sens strict du terme. Bref, bravo, vraiment, parce que l’ensemble se tient en un souffle haletant, et se lit de même. Les extraits seront un peu plus longs que d’habitude, car Carlotta n’est pas très laconique pour mon plus grand plaisir. Commission de libération conditionnelle:
« Un petit sourire réussit tout de même à se frayer un chemin jusqu’à ses lèvres -si faux qu’il lui fit l’effet d’une couche de cire chaude sur son vrai visage. De nouveau, elle déglutit et de nouveau elle dit ce nom, si fort que c’en devenait presque une moquerie. Elle fit semblant de croire qu’on lui avait demandé le nom de son frère. Dustin Chambers.
-Parfait, monsieur Chambers, continua l’autre. Je vois ici que vous avez purgé vingt ans d’une peine de vingt-deux ans assortie d’une période de sûreté de douze ans et demi pour un braquage à main armée.
Carlotta confirma d’un signe de tête. Sans compter l’année de détention provisoire, mais on va pas chipoter et répondit: « C’est exact. » Comment j’ai pu tenir vingt et un ans et plus, c’est que j’suis une putain de bruja*. »
Carlotta est transgenre, Carlotta sort de prison, et elle va nous raconter ce qu’elle y a vécu – l’enfer – et ce qu’elle y a appris, elle va nous raconter sa sortie, la perte de tous ses repères dans sa ville, son quartier, et avec les siens, famille et connaissances. Retour au monde:
« Quand elle arriva à la porte et découvrit la coulée de boue humaine qui déferlait dans la 42e, elle se fit l’effet d’un éléphant d’Afrique un peu simplet qui essaierait de s’incruster dans un jeu de corde à sauter. Les buildings vomissaient des Asiatiques et des Blancs, à fond dans le personnage du Cadre Sup pour qui n’existe rien d’autre que son portefeuille d’actions. Des chauffeurs de taxi du Moyen-Orient la klaxonnèrent – peut-être pour lui faire du gringue, peut-être pour l’insulter, peut-être simplement pour qu’elle libère le passage. Des Latinas et des Sud-Asiatiques traversaient en dehors des clous, et un jeune Black avec une monumentale coupe afro filait à toute vapeur sur le trottoir, fendant la foule furieuse. Le brother en a pas rien à foutre de rien, j’adore. Tout là-haut dans le ciel, des poutres IPN rouge vif suspendues à une grue d’une hauteur phénoménale tournoyaient, instables, dans la stratosphère. »
Seule Doodle, son amie, va être présente vraiment pour l’épauler. Et suivre ces deux nanas en goguette, ça n’est pas triste. Des scènes extrêmement drôles, beaucoup, et en fond sonore de la lectrice le cerveau de Carlotta qui discute avec lui-même, et puis en ce qui me concerne, le cœur serré souvent, beaucoup d’émotion et de compassion, mais pas juste ça, de l’affection pour cette personne qui sait très bien qui elle est, mais que les autres ne discernent que de manière floue, hésitante, indéfinie.
Rencontre avec Lou, la conseillère d’insertion:
« Elle hocha la tête. « Merci d’être arrivée jusqu’à nous, Carlotta. Sincèrement, on est passés à deux doigts du viol. »
-À deux doigts de quoi? Du viol? » s’indigna Carlotta. Elle se tourna sur le côté, croisa les jambes et, par habitude, se prépara à se faire agresser. Au secours, est-ce que ça va être comme au bloc D, où ça viole à tout va, genre On est plus en sécurité nulle part, ma pauv’ dame, avec les surveillants qui participent et qui font mine qu’y s’est rien passé, même que tu vas voir ces connards pour porter plainte? Merde, ils l’écrivent carrément dans les rapports: Y A PAS PERSONNE QU’A VIOLÉ PERSONNE. C’est quoi, l’idée? Le système tout entier te viole et t’as juste qu’à fermer ta gueule?
Lou se prit le front entre le pouce et l’index et serra comme un étau.[…]. « Que je suis bête! J’ai trop l’habitude de notre jargon et personne ne m’a jamais reprise. Je voulais simplement dire qu’on était à deux doigts d’un viol caractérisé de vos clauses de remise en liberté. Mais vous avez raison, c’est un mot extrêmement malheureux. Je ne vais pas vous toucher, Carlotta. »
Carlotta Mercedes est bien une femme. Dire ça à son fils, à sa mère, à tout le monde…C’est le parcours chaotique de cette superbe Carlotta qui nous est conté.
La prison d’Ithaca et les viols, 20 ans dans la violence, l’abomination des conditions du quotidien, il a fallu à cette chère Carlotta une résistance titanesque pour survivre à tout ça. Mais Carlotta, de nature, a de la joie en elle, de la sensibilité, elle est tellement attachante et émouvante. Pourquoi vous en dirais-je plus? Les scènes de la fête funéraire, le bazar à tous les étages, et Carlotta, au milieu de tout ça, qui cherche à trouver sa place, dans sa maison, mais dans les cœurs…elle a conquis le mien. Sur un sujet « casse-gueule », une œuvre vive, brute, sans afféterie – c’est le moins qu’on puisse dire – et extrêmement touchante et tendre.

Conversation entre Doodle et Carlotta, à propos du fils, Iceman, qui joue à Super Mario non stop enfermé dans sa chambre en compagnie de Dieu:
« Doodle prit sa voix la plus douce. « En même temps, on peut comprendre ce jeune homme, qui s’est cherché un père toute sa vie, dit-elle en désignant Iceman d’un geste plein de tact. Et là…
-Et là, quoi? Y se retrouve avec moi? Spère que vous savez faire la différence entre « un père » et moi, d’accord? C’est comme ces enfoirés qui disent « un Noir » pour Barak Obama, comme si c’tait le premier négro venu qui dort dans le métro et pas un individu qu’a réussi des trucs en veux-tu en voilà, qu’est couvert d’étoiles d’or et tout, qu’a fait des choses que même les Blancs sont pas capables de faire. Lors si ce que tu veux, c’est « un père », va falloir que tu révises ta conception de ce que ça veut dire ou que tu fasses avec ce que t’as devant toi. Y a pas tromperie sur la marchandise, comme disait Géraldine. » Telle une pin-up, Carlotta mit les mains à la taille et se déhancha. »
Donc, je mets quelques phrases, pour vous donner une idée du ton, mais surtout, je vous invite à découvrir ce roman incroyable, déjanté et admirable. Et la belle Carlotta aux chaussures dépareillées, face au monde. Coup de cœur évident.
Lou :
« -Pour tout vous dire, moi aussi je fais partie de la communauté de l’alphabet LGBTQIA+. La beauté de la chose, c’est qu’une fois qu’on a dit ça, les gens sont quand même obligés de deviner à quelle lettre on correspond. »
Et une chanson, choisie dans la bande-son conséquente de ce roman jubilatoire. Dur de choisir entre toutes les versions, j’aime bien celle-ci, qui doit faire du bien à Carlotta, quand elle fait son échappée au bord de mer, vers la fin du roman