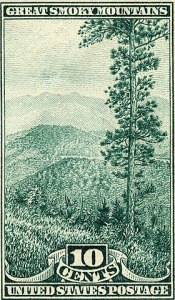Un…
Je ne suis pas moi parfois, je est Gargan. En vrai je suis cet autre. celui de l’ombre. Celui de l’eau. Blond, fragile, impuissant. Ne me demande pas qui je suis, car cela me fait peur. Demande-moi autre chose, je peux te raconter mes souvenirs. Comment le monde de la matière ferme s’est foncièrement évaporé et comment le souvenir est devenu le socle ultime de ma personne qui a bien failli elle aussi se volatiliser en colonne de vapeur d’eau. Si je plonge dans le passé, je veux le faire en toute conscience, je veux être entier comme le sont la majorité des gens sur terre. »
Il y a des livres, parfois, qui comme celui-ci me font peur au moment d’en parler. Peur de ne pas savoir relater ce qui s’est passé dans la lectrice au fil de ce récit. Peur de « l’abîmer ». Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on partage avec un personnage autant de sa vie et de son intimité. Et c’est un sacré don de soi que ce livre de Faruk Sehić, qui combattit durant la guerre de Bosnie et fût gravement blessé. Car si ce roman n’est pas purement autobiographique, l’auteur aborde son personnage comme un frère qui serait peut-être son jumeau, son double?
Roman fleuve. L’Una – et l’eau – est personnage majeur dans toute l’histoire, de l’enfance à l’âge adulte.
« Combien j’adorais la pluie quand elle déferlait sur l’eau. La goutte qui vient frapper la surface qui la relance droit dans l’air à la façon d’une fontaine. Des milliers de gouttes de pluie bondissent dans la rivière, et autour de chacune apparaissent des petits ronds qu’on peut prendre dans un battement de cils pour des nénuphars. Si l’averse est brusque et copieuse, on dirait des lances verticales qui se soudent à la rivière ou qui giclent et filent quelque part dans le ciel par-dessus les monceaux de nuages. »
Bien sûr ce roman est un récit de guerre d’une violence inouïe. Mais la grande première partie de l’histoire que nous conte l’auteur qui est aussi poète -et on le saisit tout de suite – est une promenade dans une enfance près de l’Una, cette rivière où enfant le narrateur passe tout son temps, à pêcher, à regarder, et je crois que ce sont tous ces passages d’aventures enfantines les pieds dans l’eau qui m’ont emmenée sur ses pas.
« L’Una avec ses rives était mon refuge – forteresse verte impénétrable. C’est là sous les branches feuillues que je me cachais des hommes. Seul dans le silence cerné par la verdure. Je n’entendais que le travail de mon cœur, le battement d’ailes des mouches et le clapotis quand le poisson se jette hors de l’eau et y retourne. Ce n’est pas que je détestais les hommes, mais je me sentais mieux parmi les plantes et les animaux sauvages. Quand j’entre dans un fourré de la rivière, plus rien de mal ne peut m’arriver. »
Poète. L’écriture est d’une force, d’une beauté incroyables, elle saisit au ventre et fait monter les larmes. D’émotion simple.
Puis viendra le maelström de la guerre, et je n’ai pas la présomption de « résumer » ici cette histoire. L’auteur met en fin du livre un glossaire et une chronologie de l’histoire de la Yougoslavie depuis 1945.
« Le remord n’existe pas et personne ne viendra murmurer à ton oreille: l’ennemi aussi est un être humain. Sur le champ de bataille, il en va autrement: l’ennemi est un ennemi. Il ne peut pas être humain. l’ennemi doit être un hyménoptère visqueux avec des cornes et des pieds de cochon, alors tire et laisse tomber les fadaises qui occupent les lâches et les philosophes. J’ai tué au corps à corps quelques éléments ennemis c’est pourquoi mes concitoyens me fuient, et quand je marche dans la rue tout le monde traverse. J’ai la capacité de flairer leur peur. »
Une fête foraine, un fakir et le personnage plonge dans son passé, dans une longue glissade comme une entrée dans l’eau, dans l’Una, et son environnement d’arbres, de buissons, d’herbes et de bestioles, sans parler des poissons et de la pêche, sur cette berge où il accède par la cour de la petite maison de sa grand – mère bien aimée. Il partage avec nous, dans des pages sublimes, cette époque de l’enfance et déjà l’univers intérieur de celui qui deviendra soldat du chaos. Ce chaos qu’il tente de faire sortir de sa tête et de son cœur avec le fakir ( quelle belle idée, le fakir ! ). Et la poésie.
Pas plus, sinon que peu de livres sur ce sujet ont cette force, ici si intense par l’écriture merveilleuse, et surtout est remarquable le choix narratif qui alterne tensions et rêveries, cruauté et souvenirs tendres, une stratégie de résistance grâce à l’acquis heureux des jeunes années pour contrecarrer l’extrême brutalité de la guerre.
« Vive la dépression! Voilà pourquoi je me suis employé de toutes mes forces à bloquer les formes et les contenus des images de guerre, j’ai voulu les refouler au plus profond, comme quand on noie quelqu’un et qu’on pousse des pieds sur ses épaules pour l’enfoncer un peu plus bas, dans le noir tout au fond où se tiennent les huchons, jusqu’à ce qu’il perde souffle. J’ai voulu être comme les autres qui sont indemnes, inséré dans la société, normal et gris. Si j’entrouvrais les yeux furtivement, les serpents dans le turban du fakir se mettaient à siffler et leur langue frétillait à une vitesse de plus en plus folle. Le fakir me faisait savoir que je devais me libérer des formes et des contenus des images de guerre. »
Pour conclure, une des lectures les plus fortes de ce début d’année pour moi, j’en parle en en ressentant encore tout ce qui a vibré et résonné à cette lecture. Je suis très consciente que cette petite chronique ne fait que frôler les eaux profondes de ce livre qui est une immersion, parfois en apnée, dans la vie d’un homme. C’est d’une grande intelligence et d’une aussi grande sensibilité. Bouleversant, tendre et douloureux, une merveille littéraire. Une chanson, dans ce livre: