« Les dépressifs aiment le spectacle de la pluie. Le commissaire Soneri ne savait plus où il l’avait lu et fut rassuré de constater que lui ne l’était pas du tout. D’une sale humeur, peut-être, mais dépressif, certainement pas. Toute cette pluie s’agitant dans un vent capricieux, les rues réduites à des torrents, les façades sombres et trempées, les chauffeurs impuissants dans les embouteillages se défoulant à coups de klaxon l’avaient tellement foutu en rogne qu’il avait décidé de prendre des dispositions. Tout d’abord, éviter les réunions du questeur, ensuite, et de manière générale, rester à distance. Enfin, se trouver un peu de distraction. »
Comme pour pas mal d’autres séries au personnage récurrent, je prends le train en marche. C’est le deuxième roman de Valerio Varesi que je lis et c’est un vrai bonheur de retrouver le commissaire Soneri, dans Parme en hiver, sous la pluie. Car ce personnage, cet homme nostalgique et souvent désabusé – mais pas blasé – est attachant.
 Notre commissaire va ici faire face à la mort d’un ancien « camarade » révolutionnaire, et au « suicide » d’un inconnu, le même jour. Rien ne semble relier les deux morts. L’histoire nous démontrera que ce n’est pas si évident que ça. Le commissaire Soneri est attachant pour de multiples raisons, dont la droiture, la capacité d’attention qui est une qualité majeure dans son métier, une grande honnêteté intellectuelle. Par exemple dans sa manière de regarder sa ville, Parme et sa pluie.
Notre commissaire va ici faire face à la mort d’un ancien « camarade » révolutionnaire, et au « suicide » d’un inconnu, le même jour. Rien ne semble relier les deux morts. L’histoire nous démontrera que ce n’est pas si évident que ça. Le commissaire Soneri est attachant pour de multiples raisons, dont la droiture, la capacité d’attention qui est une qualité majeure dans son métier, une grande honnêteté intellectuelle. Par exemple dans sa manière de regarder sa ville, Parme et sa pluie.
De piste en piste, de lieux en lieux, parfois avec son amie amante Angela, il va mener ses enquêtes sur les meurtres. Dans la première partie du roman, après avoir recueilli les premiers constats sur les lieux, il s’avère que la pendaison évidemment ressemble plutôt à un suicide avec une étrange mise en scène – quant à la mort d’Elmo, Guglielmo Boselli, un militant communiste de l’année 68 dans les mouvements étudiants c’est assez clairement un assassinat.
« …chef de meute, un type qui enflammait les foules pendant les assemblées, dans les cortèges de tête et les affrontements avec les flics, ou les fascistes – qui à l’époque, étaient considérés comme du pareil au même.
Toutefois, à l’inverse de la Vespa, le commissaire n’avait pas reconnu Elmo, étendu sur la pelouse, trempé et perclus de blessures. Et ce n’étaient pas les coups de couteau qui en étaient la cause: c’était le temps qui avait provoqué les dégâts les plus grands. »
Le commissaire Soneri chez qui le meurtre d’Elmo éveille ses propres souvenirs, alors…
« Il était fatigué d’explorer le passé: il n’offrait que de la douleur. »
Ainsi le roman va se dérouler comme une enquête, bien sûr, avec des tâtonnements, des excursions en Ligurie, mer ou montagne, pour rencontrer des témoins, des gens qui connaissaient Elmo, mais c’est surtout le pendu qui va donner du fil à retordre à Soneri.
 Si vous avez lu Valerio Varesi, vous savez qu’il aime la bonne nourriture, qu’il préfère la mer à la montagne et que la nostalgie l’accompagne pas mal. En cela il est attachant. Tous les passages de ses escapades, professionnelles ou pas, en compagnie d’Angela sont comme des pauses; il y a une telle complicité entre ces deux personnes, une compréhension mutuelle, un amour si clair, c’est très agréable à lire parce que les dialogues sont si fins, rendus avec beaucoup de simplicité, sans emphase ou exagération. Tout est dans la bonne mesure chez Valerio Varesi. Qui plus est, c’est une enquête où l’émotion affleure souvent chez le commissaire. On a ici un aperçu de ces années révolutionnaires en Italie, des dérives qui suivirent, des renoncements, peu à peu…l’âge venant.
Si vous avez lu Valerio Varesi, vous savez qu’il aime la bonne nourriture, qu’il préfère la mer à la montagne et que la nostalgie l’accompagne pas mal. En cela il est attachant. Tous les passages de ses escapades, professionnelles ou pas, en compagnie d’Angela sont comme des pauses; il y a une telle complicité entre ces deux personnes, une compréhension mutuelle, un amour si clair, c’est très agréable à lire parce que les dialogues sont si fins, rendus avec beaucoup de simplicité, sans emphase ou exagération. Tout est dans la bonne mesure chez Valerio Varesi. Qui plus est, c’est une enquête où l’émotion affleure souvent chez le commissaire. On a ici un aperçu de ces années révolutionnaires en Italie, des dérives qui suivirent, des renoncements, peu à peu…l’âge venant.
Reste que c’est bel et bien un polar, avec deux enquêtes qui d’une certaine façon ont un lien qui parle de la société italienne, de politique aussi. Avec des temps lents, des accélérations parfois, et puis ça joue les montagnes russes et les coupables seront bel et bien dévoilés. Soneri, et le chef, une fin pessimiste – comme le roman finalement, qui parle des désillusions – .
« – Je ne suis pas sûr qu’il soit autant coupable que ça, jugea le commissaire.
-Que voulez-vous dire?
– Rien, rien…Je pense qu’il peut bénéficier d’un certain nombre de circonstances atténuantes. Et que le problème est plus général. Qu’en somme ce n’est pas seulement le problème de Filippo et de son père…Il n’y a plus de continuité entre générations, tout est à recommencer. Même les enfants des révolutionnaires sont de droite.
-D’accord, commissaire, mais quel genre de discours tenez-vous? Qu’avons-nous à voir avec la politique et tout ce qui s’ensuit? se récria Coriani.
-Rien, rien… , répéta Soneri, déçu et rempli d’amertume. Nous, on est seulement là pour ramasser les morceaux. »
Valerio Varesi trace les traits de notre temps, ses travers, ses dégradations, abordant des thèmes politiques, sociaux et humains. Sans grand optimisme, c’est certain. Avec un talent indéniable, ce qui donne une très bonne littérature. Formidable.
« Le temps nous transforme , on a souvent l’impression que nos actes passés ne nous appartiennent plus, ou qu’ils appartiennent à une autre personne qu’on aurait enterrée petit à petit, jour après jour. »
Et comme Parme, c’est aussi lui…

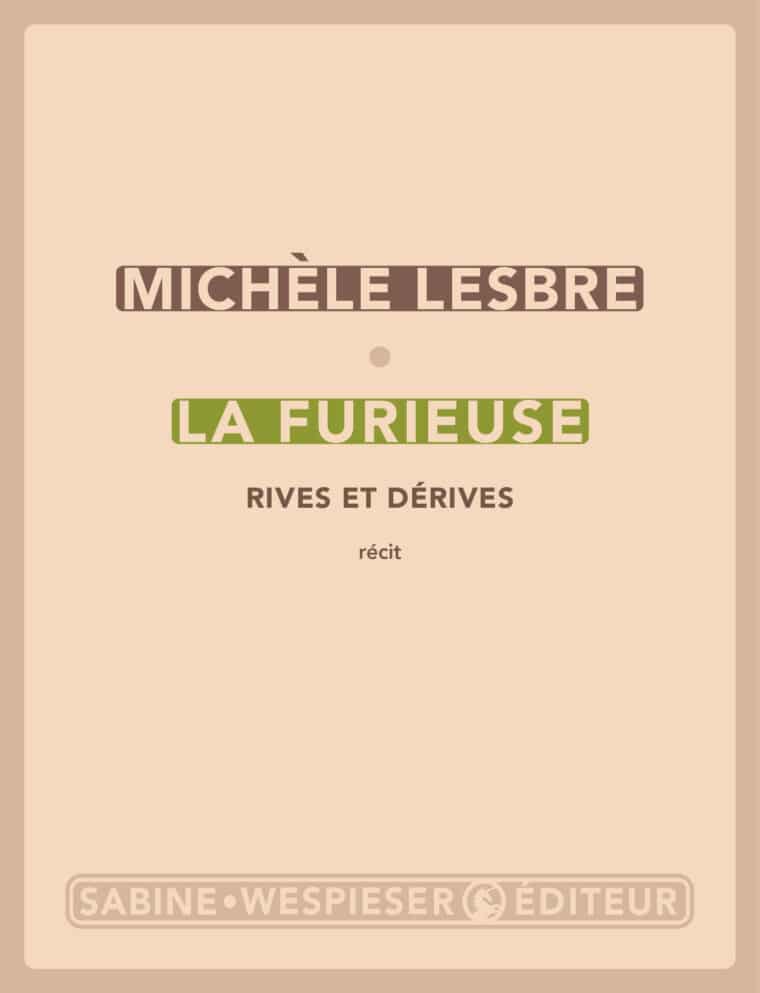








 « Vous savez comment c’est quand on a bourlingué trop longtemps et qu’on s’est trop souvent donné du cran à l’aide de quatre doigts de Jack accompagnés d’une bière pour faire passer, ou avec n’importe quelle sorte de cachetons à portée de main. Et si ça ne suffisait pas, peut-être en doublant la mise le matin venu avec une demi-douzaine de grands verres de vodka agrémentée de glace pilée, de cerises et de tranches d’orange, pour bien renvoyer à la cave araignées et serpents.
« Vous savez comment c’est quand on a bourlingué trop longtemps et qu’on s’est trop souvent donné du cran à l’aide de quatre doigts de Jack accompagnés d’une bière pour faire passer, ou avec n’importe quelle sorte de cachetons à portée de main. Et si ça ne suffisait pas, peut-être en doublant la mise le matin venu avec une demi-douzaine de grands verres de vodka agrémentée de glace pilée, de cerises et de tranches d’orange, pour bien renvoyer à la cave araignées et serpents. Plus que jamais, James Lee Burke infiltre les tréfonds de l’âme humaine, dans ce qu’elle a de plus laid comme dans ce qu’elle a de plus beau, les deux se confondant, se heurtant dans un combat constant. Un des personnages importants, Marcel LaForchette détenu à la prison de Huntsville:
Plus que jamais, James Lee Burke infiltre les tréfonds de l’âme humaine, dans ce qu’elle a de plus laid comme dans ce qu’elle a de plus beau, les deux se confondant, se heurtant dans un combat constant. Un des personnages importants, Marcel LaForchette détenu à la prison de Huntsville: « Il y a des années, il avait arraché une photo en noir et blanc d’une histoire illustrée de la Deuxième Guerre Mondiale, et il la gardait dans son portefeuille, protégée par une pochette en celluloïd. La photo montrait une femme voûtée montant un chemin de terre avec ses trois petites filles. La femme et les enfants portaient des chiffons sur la tête, et avaient le dos couvert de manteaux bon marché. La plus jeune des fillettes était tout juste en âge de marcher. On ne pouvait voir ce qu’il y avait au bout du chemin. À l’arrière-plan, il n’y avait ni arbres, ni herbe.
« Il y a des années, il avait arraché une photo en noir et blanc d’une histoire illustrée de la Deuxième Guerre Mondiale, et il la gardait dans son portefeuille, protégée par une pochette en celluloïd. La photo montrait une femme voûtée montant un chemin de terre avec ses trois petites filles. La femme et les enfants portaient des chiffons sur la tête, et avaient le dos couvert de manteaux bon marché. La plus jeune des fillettes était tout juste en âge de marcher. On ne pouvait voir ce qu’il y avait au bout du chemin. À l’arrière-plan, il n’y avait ni arbres, ni herbe. « Nous roulâmes jusqu’au Vieux Carré, Clete gara sa Caddy à son bureau, puis nous prîmes un dîner tardif au Acme Oyster House, sur Iberville. Après avoir quitté le domaine des Balangie, nous avions peu parlé, en partie parce que nous étions en colère et honteux, que nous soyons ou non prêts à l’admettre. Des gens dont la fortune provenait des narcotiques, de la prostitution, de la pornographie, de prêts avec usure, du racket et du meurtre nous avaient virés comme si nous avions été de modestes flics en patrouille ignorants et indignes de se trouver dans leur maison. »
« Nous roulâmes jusqu’au Vieux Carré, Clete gara sa Caddy à son bureau, puis nous prîmes un dîner tardif au Acme Oyster House, sur Iberville. Après avoir quitté le domaine des Balangie, nous avions peu parlé, en partie parce que nous étions en colère et honteux, que nous soyons ou non prêts à l’admettre. Des gens dont la fortune provenait des narcotiques, de la prostitution, de la pornographie, de prêts avec usure, du racket et du meurtre nous avaient virés comme si nous avions été de modestes flics en patrouille ignorants et indignes de se trouver dans leur maison. » Tout ceci donne lieu à des pages sublimes, et je pèse le qualificatif. Tant dans les scènes d’action que dans les contemplations mélancoliques, aussi bien dans les dialogues, en particulier les conversations des deux amis rehaussées d’humour, que dans les moments songeurs de Robo – joli surnom – , on atteint là un niveau impressionnant de talent pour parler de ce que sont les hommes et de la consolation que peut apporter la nature. Comme cette introspection de Dave, un soir.
Tout ceci donne lieu à des pages sublimes, et je pèse le qualificatif. Tant dans les scènes d’action que dans les contemplations mélancoliques, aussi bien dans les dialogues, en particulier les conversations des deux amis rehaussées d’humour, que dans les moments songeurs de Robo – joli surnom – , on atteint là un niveau impressionnant de talent pour parler de ce que sont les hommes et de la consolation que peut apporter la nature. Comme cette introspection de Dave, un soir. Histoire, poésie, la grande culture de l’auteur qui pour autant ne renonce pas à l’humour… un roman impressionnant.
Histoire, poésie, la grande culture de l’auteur qui pour autant ne renonce pas à l’humour… un roman impressionnant.




