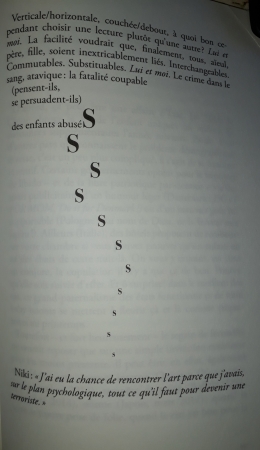1
Dimanche 5 avril 1987
-C’est là.
Je me suis surpris à murmurer.
Là, au bout de cette route.
Une départementale en lacet qui traverse les vignes et les champs paisibles de l’Ain, puis grimpe à l’assaut d’une colline, entre les murets de rocaille et les premiers arbres de la forêt. Lyon est loin, à l’ouest, derrière les montagnes. Et Chambéry, de l’autre côté. Mais là, il n’y a rien. Quelques fermes de grosses pierres mal taillées, calfeutrées au pied des premiers contreforts rocheux du Jura.
Je me suis assis sur un talus. J’ai eu du mal à sortir mon stylo. Je n’avais rien à faire ici. J’ai ouvert mon carnet sans quitter la route des yeux.
« C’était là », il y a quarante- trois ans moins un jour.
Cette même route au loin, sous la lumière froide d’un même printemps. »
Ainsi commence ce roman autobiographique qui fait suite à « Profession du père ». Sorj Chalandon boucle ici l’enquête, en quelque sorte, qu’il a menée sur son père. Cet écrivain dont j’aime et l’écriture, et les propos m’avait bouleversée avec « Profession du père » et une histoire d’enfance si tordue, si triste qu’on a même du mal à croire qu’une personne, un père en l’occurrence, de cette sorte puisse exister et qu’un enfant puisse en sortir comme l’a fait Sorj Chalandon. Et pourtant. J’imagine la souffrance qu’il a pu ressentir en écrivant ces deux récits. Comme l’extraction d’une mauvaise dent qui fait souffrir, taraude, harcèle et prend toute la place, parce qu’elle fait partie de nous, l’écrivain a voulu faire place nette et tenter d’extirper un peu de vrai de tout ce qu’il savait faux des dires de ce père, sinistre et pitoyable personnage. Et néanmoins : son père. Quand il lui dit « Papa », ça me fait mal pour lui, le fils, l’enfant de salaud..
 Sorj Chalandon écrit bel et bien un roman, car il fait coïncider sa découverte du dossier de son père avec le procès de Klaus Barbie à Lyon, en 1987, alors qu’il a obtenu ce dossier, son père déjà mort. Sorj Chalandon couvre le procès avec un reportage pour le journal Libération, ce qui lui vaudra le prix Albert Londres ( pour ce reportage et ses reportages sur l’Irlande du Nord ). Dans ce roman, donc toujours tenu par le désir et l’impérieux besoin de comprendre qui est son père, il se décide à chercher, une seconde enquête en marge du procès mais en fait en lien total. L’auteur qui au début du livre se trouve à Izieu, bouleversé par cet endroit et l’histoire sinistre qui s’y déroula, est ramené à son père qui l’a abreuvé de mensonges, qui l’a maltraité et qui sans relâche poursuit sa mythomanie fantasque et cruelle.
Sorj Chalandon écrit bel et bien un roman, car il fait coïncider sa découverte du dossier de son père avec le procès de Klaus Barbie à Lyon, en 1987, alors qu’il a obtenu ce dossier, son père déjà mort. Sorj Chalandon couvre le procès avec un reportage pour le journal Libération, ce qui lui vaudra le prix Albert Londres ( pour ce reportage et ses reportages sur l’Irlande du Nord ). Dans ce roman, donc toujours tenu par le désir et l’impérieux besoin de comprendre qui est son père, il se décide à chercher, une seconde enquête en marge du procès mais en fait en lien total. L’auteur qui au début du livre se trouve à Izieu, bouleversé par cet endroit et l’histoire sinistre qui s’y déroula, est ramené à son père qui l’a abreuvé de mensonges, qui l’a maltraité et qui sans relâche poursuit sa mythomanie fantasque et cruelle.
« Non. Le salaud, c’est l’homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue. Sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité. Qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui. Qui s’est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous: les nazis qui l’ont interrogé, les partisans qui l’ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires. Qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste. Qui a passé sa guerre puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres. Puis les miennes.
Le salaud, c’est le père qui m’a trahi. »
La quatrième de couverture donne un des meilleurs extraits du livre de « cet enfant de salaud », qui résume à lui seul d’une part les actes du père, d’autre part la colère et surtout la souffrance du fils, privé de tout ce qui est le père, un père. Et on a le sentiment en lisant ce livre que jamais il ne s’en remettra, et c’est bouleversant. Pour moi presque traumatisant.
Ainsi, suivant le parcours d’un père fou à travers les rapports de police, divers papiers qu’il arrive à exhumer, il suit une piste tortueuse et surtout inepte, incompréhensible tant va se révéler grand l’écart entre les dires et les faits. Et tant le père ressort de cette enquête veule, lâche, et finalement complètement fou.
Dans cette vidéo, Sorj Chalandon explique comment s’est construit ce roman.
Quant au procès, le fils en profite pour observer son père venu y assister, voir ses réactions, les expressions de son visage. Ce salaud de père semble aimer particulièrement les interventions de Me Vergès et être bien peu atteint par les témoignages des rescapés des camps, des interrogatoires et des tortures de la Gestapo. Extrait particulièrement abominable:
« À propos d’un témoin, femme violée par un chien dans le bureau de Barbie:
« -La torture est liée dans l’imaginaire, à la sexualité. Pour qu’un chien puisse violer une femme, il faut que celle-ci l’y incite, au moins par une posture indécente. »
Dans la salle ce fut la consternation. Deux avocates se sont levées.
« -Un chien ne peut pas posséder une femme, mais seulement une chienne, à quatre pattes. »
Le témoin qui avait rapporté la scène s’est levé en criant.
« -Ce que je dis est vrai! »
Simone Lagrange, jeune fille torturée devant ses parents, s’est dressée à son tour, hors d’elle, avant de se rasseoir, de se tasser sur sa chaise et pleurer. Vergès, lui, a continué, sans un regard pour ces détresses.
« -L’évolution des fantasmes de certains témoignages pourrait intéresser les psychiatres, pas la justice ! »
Silence dans le public. Les journalistes notaient, tête baissée. »
Sorj Chalandon relate le témoignage de Geneviève De Gaulle-Anthonioz, alors que ce jour-ci son père est absent.
« Jeune étudiante en histoire, Résistante, arrêtée, battue, déportée à Ravensbrück, elle a évoqué l’acharnement des nazis à fabriquer des « sous-êtres ». Pas un mot brisé lors de son témoignage, pas une phrase en larmes, pas une plainte, pas un sanglot. Elle a partagé avec nous l’image des nourrissons noyés dans un seau à la naissance. La stérilisation forcée des gamines tsiganes de 8 ans. La nièce du Général nous a raconté à quoi s’amusaient les bandes d’enfants abandonnés qui survivaient derrière les barbelés.
-Ils jouaient au camp, monsieur le Président.
Sa voix douce.
-L’un tenait le rôle du SS, les autres des déportés. »
J’aurais tellement aimé que tu apprennes cela.
Et que tu voies cette grande petite dame s’écrouler d’un malaise cardiaque sur les marches du palais de justice en sortant de l’audience, terrassée par ce qu’elle venait de revivre, et mourir à nouveau pour nous tous. »
 On va les entendre, ces témoins, et ça donne des pages terrifiantes, qui désespèrent de ce que peut être parfois un être humain. L’auteur, écoutant cela et mettant en parallèle les mensonges multiples de son père est totalement effondré et entre alors dans une colère froide, allant enfin au bout et parvenant à mettre son père au pied du mur.
On va les entendre, ces témoins, et ça donne des pages terrifiantes, qui désespèrent de ce que peut être parfois un être humain. L’auteur, écoutant cela et mettant en parallèle les mensonges multiples de son père est totalement effondré et entre alors dans une colère froide, allant enfin au bout et parvenant à mettre son père au pied du mur.
Ce livre m’a touchée profondément. Outre la sympathie et une sorte de solidarité ressentie pour l’auteur – le mot « empathie » commence à m’agacer, mis à toutes les sauces…-, il est toujours utile de revivre ce genre de procès, et de se souvenir de ce qu’est réellement une dictature, de se souvenir de ce que sont capables d’infliger à des êtres humains d’autres êtres humains à partir de théories nauséabondes. Il est utile et urgent de s’en souvenir.
Pour moi, Sorj Chalandon est vraiment ce qu’on appelle « un grand bonhomme » qui chaque fois qu’il écrit m’atteint émotionnellement. Je dois le dire, et je le salue : respect, Monsieur.
« Klaus Barbie est mort à Lyon le 25 septembre 1991, incarcéré à la prison Saint-Paul.
Il avait 77 ans.
Mon père est mort à Lyon le 21 mars 2014, interné à l’hôpital psychiatrique de Vinatier.
Il avait 92 ans.
Le dossier de la Cour de Justice de Lille, qui lui était consacré, était conservé aux Archives départementales du Nord sous la cote 9W56. J’ai pu l’ouvrir le 18 mai 2020, six ans après sa disparition. Grâce au travail, à l’attention et à la délicatesse de Mireille Jean, directrice des Archives, et de son équipe. »